Je ne sais faire qu'une seule chose à la fois. Et c'est pour cela que j'ai fait tant de choses différentes. Jamais en même temps. Quand je fais de la peinture, je parle peinture, je mange peinture, je bois peinture, je dors peinture, je rêve peinture, je pense peinture, je suis le tableau que je peins.
Maryse Choisy, Mes Enfances, p.140
Maryse Choisy était aussi peintre.
A notre connaissance, sa peinture n'est malheureusement plus visible, si ce n'est par la reproduction de cet autoportrait de 1947 qui servit d'illustration pour la couverture du livre de Bernard Guillemain, Maryse Choisy ou l'amoureuse sagesse :
Nous pouvons seulement nous faire une idée du grand Christ qu'elle exposa au Salon d'art religieux de 1943 grâce à cette photographie de 1957 :
Bernard Guillemain a dit de sa peinture :
Rien de moins académique que la peinture de Maryse Choisy. Rien qui obéisse moins à un modèle. Elle n'a jamais appartenu à aucune école. Elle n'a jamais cédé à aucun conformisme. Elle ne renie pas la peinture figurative parce qu'elle s'adonne à la peinture abstraite. Elle est portraitiste et paysagiste. Elle exécute des tableaux de genre mais aussi des toiles religieuses. Elle dessine avec soin et elle est coloriste. Elle ne sacrifie pas la richesse de la ligne à la richesse de la palette ; mais elle a une palette variée, nuancée, modulée...
Dans tous les tableaux de Maryse Choisy, que je connais, il y a une couleur dominante, rarement deux, exceptionnellement trois. Et ces couleurs jouent et chantent dans un entrelacs de lignes courbes, dans un poudroiement de taches de lumière. Des périodes se sont succédées selon les couleurs favorites : jaune, bleu, or...
Il est à peu près impossible de parler de peinture quand on ne peut pas faire admirer des œuvres. Je ne puis malheureusement vous faire voir ni le grand Christ, ni les valseurs tourbillonnants, ni les portraits d'elle-même, de Maxime Clouzet, ni une vue d'un ashram, presque absorbé dans la contemplation mystique et réduit à une ombre dorée sur un fond très sombre, ni l'extraordinaire abstraction qui domine la porte du bureau.
C'est de la vie, de la vie rêvée. C'est un rêve qui est devenu clarté plus réelle que la réalité.
(Maryse Choisy ou l'amoureuse sagesse, p. 168)
Maryse Choisy a commencé à exposer en janvier 1930, Galerie Gerbo, à l'Exposition des Écrivains-Peintres, en compagnie de Henri Béraud, André Billy, Lucie Delarue-Mardrus, Bernard Grasset, Sacha Guitry, Emile Henriot, Pierre Mac Orlan, la comtesse de Noailles, Andrée Sikorska, André Thérive, Paul Valéry, Paul Morand....
Un journaliste, rendant compte de l'exposition, décrivit ainsi l’œuvre qu'y présentait Maryse Choisy :
Un journaliste, rendant compte de l'exposition, décrivit ainsi l’œuvre qu'y présentait Maryse Choisy :
« Les Sept Planètes » dont quatre sont momentanément éclipsées puisqu'on ne peut saluer que « Delteil solarien », « Rachilde lunarienne » et M. Choisy elle-même, « vénusienne ».
Un autre journaliste précise encore :
Couleurs vives et traits fermes rehaussent une stylisation extrêmement amusante
Descriptions qui font rêver : nous aimerions pouvoir nous « amuser » aussi en contemplant ces « Sept Planètes ».
Il faut alors se consoler avec ce portrait dessiné de Joseph Delteil, qui orne la couverture du livre qu'elle lui consacre en cette même année 1930 :
Ce nez, cette oreille, cette bouche ! On sourit, on est tenté de rire. Quelles étaient les intentions de Maryse Choisy ? A-t-elle fait exprès ?
Lisons donc ce qu'elle dit de l'art dans, justement, Delteil tout nu (pp. 52-53) :
Mettre en regard le portrait de Delteil avec cet autoportrait accompagnant son livre de poèmes Fugues (1942) est du plus savoureux effet :
Maryse Choisy a réalisé d'autres portraits, comme ceux de Teilhard de Chardin et de Freud qu'elle mit en couverture des numéros spéciaux de Psyché à eux consacrés :
Dans la seconde partie de ses mémoires, Sur le chemin de Dieu on rencontre d'abord le diable (1978), Maryse Choisy raconte les changements dans sa peinture qui ont suivi un grave accident d'automobile survenu en 1945 (pp. 72-75) :
Il faut alors se consoler avec ce portrait dessiné de Joseph Delteil, qui orne la couverture du livre qu'elle lui consacre en cette même année 1930 :
Ce nez, cette oreille, cette bouche ! On sourit, on est tenté de rire. Quelles étaient les intentions de Maryse Choisy ? A-t-elle fait exprès ?
Lisons donc ce qu'elle dit de l'art dans, justement, Delteil tout nu (pp. 52-53) :
L'expression esthétique n'est guère simple. Elle met en jeu toutes les facultés, toute la vie. Le sentiment est le facteur initial, la source de l'activité artistique... Ce qui donne ligne, forme, unité, au tumulte sentimental, c'est l'intelligence. L'auto-critique, ce tamis de tout grand artiste, est une activité de l'intelligence pure. Où il y a recherche de beauté, il y a un concept de l'art. Soutenir que l'art est réglé par le goût individuel, par l'intuition, par l'arbitraire d'un caprice ou d'une mode, c'est couler dans le subjectivisme le plus absolu. Nulle distinction, nulle règle, nul effort de compréhension. En art, le subjectivisme est la négation de l'art. Dès qu'on parle d'art, dès qu'on parle de beauté, voire dès qu'on juge une chose belle, on implique tacitement :
a) Une qualité universelle propre à toutes les œuvres dites belles ;
b) Une loi (ou un standard) conformément à laquelle telle chose est belle ou laide ;
c) Une valeur, ou un système de valeurs esthétiques ;
d) Un jugement que telle œuvre possède (ou ne possède) la qualité essentielle de la beauté et se conforme (ou ne se conforme pas) à la loi qui régit la beauté.
Tout jugement esthétique présuppose une théorie plus ou moins objective de l'art. Qui cherche la beauté en créant affirme une proposition universelle (affaire d'intelligence pure). Il ne la chercherait pas s'il ne l'avait déjà trouvée. La croyance à l'art entraîne un concept de l'art. Tout artiste court après un idéal qui lui glisse entre les doigts. La création est un match entre Achille et la tortue... L'artiste rattrapera-t-il son idéal, ô Zénon ?
Cet idéal esthétique est sa réalité, son absolu hégélien. En se relisant, il examine si l'expression de son image correspond à la réalité, non pas à la réalité de l'image, mais à la réalité des relations entre l'image et son expression. Toutes les images qui grouillent dans le subconscient ne sont pas également belles. Il faut se maîtriser (hygiène ! hygiène !), renoncer aux imparfaites. L'art est une domination par le meilleur moi de tous les autre moi. Il faut choisir entre les images. Choix implique intelligence.
Mettre en regard le portrait de Delteil avec cet autoportrait accompagnant son livre de poèmes Fugues (1942) est du plus savoureux effet :
Maryse Choisy a réalisé d'autres portraits, comme ceux de Teilhard de Chardin et de Freud qu'elle mit en couverture des numéros spéciaux de Psyché à eux consacrés :
Dans la seconde partie de ses mémoires, Sur le chemin de Dieu on rencontre d'abord le diable (1978), Maryse Choisy raconte les changements dans sa peinture qui ont suivi un grave accident d'automobile survenu en 1945 (pp. 72-75) :
Ce n'est qu'après ma réaction méningée que je sus ce qu'étaient le spontané, l'inspiré en art. [...]
Le même phénomène se présenta en peinture. Jusque là, dans mes heures de loisir, j'avais fait des devoirs d'élève, bien conçus à l'avance, selon les règles les plus honnêtes du non-figuratif. A partir de mon accident, mes pinceaux couraient tout seuls dès qu'ils entraient en contact avec une toile et j'ignorais ce qui allait surgir. [...]
Parmi les tableaux peints après l'accident il en est un qui pose plusieurs énigmes au parapsychologue et au philosophe. Ici commence l'histoire, la longue histoire d'une vision inexplicable par nos explications actuelles.
Une quinzaine de jours après mon retour de clinique, au sommet de la courbe, je découvre dans un débarras une grande toile salie par quelques essais. Aussitôt je saisis avec rage des pinceaux, un couteau et toute ma palette de couleurs. Je jette du noir, du blanc, de l'indigo, du rouge de Chine, du jaune de Naples, n'importe quoi, n'importe où...
Et ce furent d'abord des rochers gris-bleu qui se confondaient avec le ciel... J'entassai encore plus gros de peinture avec un couteau. Ça commençait à ressembler à un paysage un peu terrifiant qui me hanta au cours d'un cauchemar pendant mon séjour en clinique : de l'eau sous les montagnes, un défilé, un vieux Temple... Je cultivai la ressemblance... Je mis des vagues sous les rochers, de la neige par-dessus, des clochers d'or au milieu. Le tableau fut terminé quand ma main fut lasse de projeter n'importe quelle couleur n'importe où. Pour un spectateur superficiel cette œuvre pouvait paraître le fruit du pur hasard.
... Pourquoi troublait-elle les cœurs sensibles ? A certains elle donnait un malaise. D'autres avaient envie de prier... Ce qui frappait tout le monde, c'est le rêve qui s'attachait à ces montagnes et à ces vagues.
Parfois des curieux voulaient des précisions :
— Cette eau tourmentée, c'est quoi ? La mer ?
Je démentais :
— Non. Un fleuve plutôt... Rien ne m'a servi de modèle. C'est un paysage imaginaire. Dans le catalogue de la galerie de la rive gauche où j'exposais mes œuvres en 1947, cette toile portait le titre de Temple englouti. Enthousiasmé par le quelque chose d'étrangement inquiétant qui se dégage de cette peinture, le Dr Rouhier tint à l'accrocher dans sa librairie Vega. J'eus beaucoup d'occasions de la vendre. J'ai refusé. Je ne saurais dire pourquoi j'y tiens.
Lorsqu'en 1952, Maryse Choisy visite l'ashram de Rishikesh, en Inde, elle a un choc :
Quand j'aperçus le Sivanandashram, je faillis me trouver mal. C'était l'original du tableau que j'avais cru composer sept ans plus tôt, à coups de brosse et de couteau, projetant çà et là des couleurs au hasard. [...]
Trouver, sept ans après avoir peint un paysage que j'avais cru imaginaire, le modèle saisi par télépathie est en soi si troublant que je pris un film [...]
Le Manifeste de l’École Archétypique qu'elle fait paraître dans le n°16 de sa revue Psyché en février 1948 accompagne ce changement dans son art :
Manifeste de l’École Archétypique
L'art est devenu trop intellectuel. Il a perdu ses attaches avec l'homme, les secrets qu'il tenait de sa communion avec le monde.
Pour nous il s'agit avant tout de renouer les liens non seulement avec notre ange le plus profond, mais avec tout l'inconscient collectif.
Nous voulons retrouver ces mythes éternels, qui ont mû les ressorts cachés de nos activités et leur dynamisme millénaire pour les intégrer à notre temps. Car nous représentons essentiellement notre époque.
L'art fut toujours une nostalgie de l'inexprimé, spirituel et instinctuel, c'est-à-dire de tout ce qui échappe à la conscience. L'artiste, comme le saint, « choisit tout ». La devise de l’École Archétypique pourrait être : « Vide ton sac ! »
On n'a jamais tout dit. Une œuvre est la meilleure approximation possible du plan originel mûri à la saison des épis en un lieu donné. C'est un moment de la pensée de l'artiste. Ce n'est pas son testament.
L’œuvre pose un problème d'abord pour celui qui la conçoit. Elle est nécessitée intérieurement. C'est pour répondre à ses propres questions, c'est pour résoudre un conflit qui le déchire, lui, bien avant ses spectateurs ou ses lecteurs, que l'artiste se met au travail. A cela se reconnaît l'authenticité d'une touche. Sans cet X initial qui hante son esprit jusqu'à l'envoûtement et dont il ne se débarrassera qu'au prix d'une œuvre, il ne produirait rien. Sa propre vérité, il veut se la confirmer à lui-même par le besoin de cette vérité chez les autres. Une sorte de tentacule lancée vers les quatre points cardinaux à la recherche de cerveaux apparentés.
Mais cette tentacule elle-même prend une vie indépendante. La créature se détache de son créateur et suit son destin propre. Par les expériences qu'elle provoque, par les controverses, par les malentendus même nés d'elle, par l'amour ou la haine qu'elle réveille sur son chemin, une œuvre devient la matière d'une œuvre nouvelle. Un artiste quelque peu scrupuleux pourrait ainsi se récréer indéfiniment.
Mais il ne s'agit pas comme les surréalistes de faire de la peinture médiumnique, de poser n'importe quoi sur une toile ou une page. On ne peut pas plus obéir passivement à n'importe qui qu'on ne peut vouloir n'importe quoi. C'est là une vue d'école primaire sur Freud. Seule la prise de conscience rend féconds les trésors cachés de l'inconscient. Pour exprimer l'inexprimable il ne faut pas être gêné par la règle, mais l'avoir digérée. Toute improvisation exige une grande maîtrise de la matière, une connaissance approfondie des ressources du langage. La technique des lumières et des couleurs doit devenir à l'état d'automatisme pour offrir un instrument souple et sensible aux activités inconscientes dictées par un impératif intérieur, archétypique.
Nous voulons dans le dépassement des sciences et des innocences aller aussi plus loin que les cubistes. Eux se sont contentés de réaliser sur la surface plane « toute la forme », c'est-à-dire un volume dont on voit toutes les faces. Nous, nous voulons même traduire sur la surface plane, le temps, le mouvement, le rythme, l'origine et la direction lointaine. « Si je connaissais tout de la rose de mon jardin, je connaîtrais le monde entier qui se reflète dans ma rose. » Notre rose dans notre durée archétypique sera à la fois graine, tige, bourgeon, feuille, fleur, fruit. Nos portraits montreront l'archétype éternel du modèle ou alors tous ses instantanés transitoires.
Voilà pourquoi au nom du symbole immuable nous crions très haut notre droit de changer, — notre liberté — dans un monde fonctionnarisé, embrigadé, « engagé ».
Le vrai mensonge est dans le style. Le grand public n'aime pas les surprises. Il est déconcerté quand un poète ou un peintre ne correspond pas à la définition qu'on lui a donnée une fois pour toutes. Définir c'est tuer. Tout ce qui est vivant change. Le propre d'un artiste c'est cette perpétuelle création. Lorsqu'un artiste se fait un genre bien précis, il témoigne de la faiblesse de sa sensibilité, de sa courte inspiration, de sa paresse... ou de son habileté commerciale. Il n' a été sincère qu'une seule fois, la première où il a inauguré son genre. Après, il ne fait plus que s'imiter lui-même.
La création est le contraire de la routine. Un artiste n'est jamais tout à fait content de ce qu'il a produit. Il y a une telle marge entre le rêve initial et sa réalisation sur une surface plane. Toute œuvre porte plus ou moins ce degré d'imperfection qui s'attache à tout ce qui vit. L'artiste se cherche. Dans chaque création il éternise en une synthèse sublime tout l'actuel d'un lieu et d'un temps donné. De sorte que le changement est la condition première de la sincérité. Seul cet amour de l'authentique peut aider à renoncer à tous les avantages d'une étiquette classée.
L'étiquette archétypique n'a d'autre étiquette que la réalité intérieure ni d'autre engagement que la vérité devant l'Art.
MARYSE CHOISY, SAMIVEL, BOCIAN,
VIRGILI LANFRANCO, MALESPINE.
S'il ne nous est plus possible de voir aujourd'hui l’œuvre picturale de Maryse Choisy, nous pouvons cependant apprécier ce qu'elle fit dans le domaine de l'illustration de livres pour enfants.
Nous reproduisons ci-dessous les dessins qu'elle fit pour ses Contes pour ma fille... et pour les autres (1943) et pour ses Contes de fées (1945), avec pour le premier de ces volumes, le commentaire qui accompagne, avant le conte, chaque dessin en pleine page.
Nous reproduisons ci-dessous les dessins qu'elle fit pour ses Contes pour ma fille... et pour les autres (1943) et pour ses Contes de fées (1945), avec pour le premier de ces volumes, le commentaire qui accompagne, avant le conte, chaque dessin en pleine page.
— Contes pour ma fille... et pour les autres :
La bague de Saint-Gildas
Ceci, ma chère chérie-amour, est le château du vilain Comorre. Les tours n'étaient pas vraiment roses. Mais comme le Roi et sa suite étaient arrivés très tôt le matin, le soleil naissant donnait à cette heure-là cette teinte rosée. Le petit Saint Trémeur n'a pas encore dit : « La Trinité fait justice ». Sinon, il n'y aurait pas de château. Mais comme tu vois, il s'avance jusqu'au bord du fossé pour y prendre la poignée de sable. Il menace du doigt. Et si Comorre avait été intelligent il aurait obéi. Mais tu sais bien que les gens méchants sont aussi bêtes.
Je n'ai pas dessiné Tréphyma, parce qu'à ce moment-là elle tenait sa tête décapitée dans ses mains. Et cela est triste.
A la fin de l'histoire tu verras le faucon qui porte la bague de Tréphyma devenue toute noire.
La fille de l'air
Eolaine suit le grand hydravion que pilote l'as Paul Vernet. Son père, le Roi des Sylphes, a déjà faussé l'hélice, comme tu peux le constater sur mon dessin, ma chère chérie-amour.
On ne voit pas le beau Paul parce qu'il est dans la carlingue. On ne voit pas non plus la forêt de Rangoon parce qu'elle se trouve en bas. Eolaine n'a plus ses ailes. Elle a des bras. Mais elle n'est pas encore descendue sur terre.
Plus loin tu remarqueras deux des douze mille frères d'Eolaine qui soufflent de toutes leurs forces sur la terrasse de Passy. Tu reconnaîtras la terrasse de Passy parce que la Tour Eiffel est en face.
Le Bouvier et la Vierge filante
C'est le septième jour du septième mois. La Vierge filante traverse le pont de Corneilles sur la Voie Lactée pour aller dire bonjour à son mari. Je n'ai pas eu assez de place pour dessiner le Bouvier. Mais tu verras plus loin la vache-fée qui fait des étoiles avec ses sabots quand elle monte au ciel.
La Vierge filante porte des habits chinois, parce qu'elle est une Déesse chinoise. Ils sont en crêpe de... Chine, naturellement. Et ils sont ornés de broderies très compliquées.
La Vierge filante tient un éventail parce que c'est la coutume de son pays mais elle n'en a sûrement pas besoin. Il y a dans le ciel assez de zéphyrs pour lui rafraîchir le visage.
Le Paradis des chats
Au milieu, il y a Juliette ou Dessin Animé, entourée d'ailes de rosée. Je n'ai pas pu faire les sept couleurs du spectre solaire parce qu'on ne me permet que deux couleurs. Mais tu peux très bien, ma chère chérie-amour, colorier toi-même le reste du dessin. Tu me l'enverras. Et je te dirai si c'est bien fait.
L'espèce de personne assise que tu vois dans le coin de droite n'appartient pas au ciel des chats. C'est une cigale curieuse qui s'est juchée sur le sommet du globe terrestre. Tu vois bien que c'est un huitième de cercle. La cigale curieuse est très ahurie.
Je n'ai pas la place de dessiner le Monsieur-qui-a-tous-les-droits-sur-ma-vie, ni l'Enfant-qui-cherche-l'Aventure, ni l'Honorable-Dame-qui-frotte-les-parquets. Mais pour te consoler, mon histoire se termine par le portrait de Kand-on-Nourry et d'un de ses garçons joufflus et joueurs. Justement il est en train de jouer avec sa petite patte levée.
Le lac des Fées
Nous voici au plus épais du bois noir. A gauche le mûrier. Il n'y a pas de tessons de bouteilles parce qu'Aurore vient de passer. Et elle a tout balayé. On ne voit pas de boîtes de sardines, parce qu'au temps de Lusignan on ne mettait pas encore les sardines en boîte. A droite, il y a le platane d'argent et sa blessure. Les lapins ont fini leurs danses et se sont sauvés quand j'ai voulu les dessiner. Mais la biche s'est étendue confortablement parce qu'elle sait qu'elle est une des principales héroïnes de cette histoire. N'est-ce pas qu'elle est belle ?
La traînée bleue à droite, c'est le lac des fées. On ne les voit pas parce que c'est l'heure où elles sont invisibles. Mélusine elle-même avec sa longue traîne ne t'apparaîtra qu'à la fin de l'histoire. On ne voit pas non plus Aurore ni la fleur blanche à huit pointes, parce que justement Aurore est en train de plonger au fond du lac pour chercher la fleur blanche à huit pointes. Et je n'ai pas le temps d'attendre qu'elle remonter à la surface. J'ai fait le lac mauve en bleu parce que je ne pouvais pas faire le ciel en mauve et que je n'ai toujours droit qu'à une couleur à la fois.
L'éventail du Prince Attan
Voici, ma chère chérie-amour, le Prince Attan et Gwennola qui jouent à cache-cache dans la forêt de Brocéliande. Justement le Prince Attan a cueilli un beau bouquet de roses pour l'offrir à sa fiancée. Gwennola a vu le Prince. Car les filles voient tout, même quand les choses se passent dans leur dos. Mais elle fait semblant de ne pas le voir. C'est pour le taquiner, tu sais.
Ce dessin est un peu noir. C'est parce que, comme je te l'ai dit, la forêt de Brocéliande est si profonde que le ciel n'y apparaît qu'en pointillé.
Sur le devant, il y a le chêne-maman qui abrita jadis Gwennola et sa nourrice. Le trou qui est au milieu de l'arbre est une blessure faite par un aurochs et qui ne s'est jamais tout à fait refermée. L'aurochs est une espèce de méchant gros boeuf qui habitait l'Europe au moyen âge. Ça s'écrit avec un s, même au singulier, parce que ça vient du mot allemand OCHS, qui signifie boeuf.
Plus loin tu trouveras un éventail de plumes de paon fabriqué par Gwennola. C'est un éventail pour petites cérémonies, comme le lever de la Reine.
La poupée de sel
Le soir tombe sur le magasin des jouets. Le rire du dernier client tinte au coin de la rue. La clef a fait « cric » « crac » dans la serrure. Toutes les poupées de sel ont quitté leur boîte, leur étagère, leur devanture. L'une d'elles dans sa précipitation s'est étalée par terre. Une autre est tombée du haut de sa commode. Tellement elles se sont dépêchées pour écouter le pantin aux joues pâles. Il fait un grand discours.
— L'Océan n'existe pas, dit-il.
Tu remarqueras qu'ont voit l'Océan par la fenêtre. Mais le pantin tourne le dos à l'Océan et à la fenêtre. C'est toujours comme ça quand les gens nient ce qu'ils ne connaissent pas. Si le pantin sautait les pages, il verrait à la fin de mon histoire le rocher de la Vierge avec tout l'Océan Atlantique derrière Biarritz.
La petite poupée blonde n'est pas dans le magasin des jouets. Elle est déjà partie avec son double décimètre pour mesurer la profondeur de la mer.
La cuiller du Diable
Au moment où tu les vois, les convives du Diable sont plutôt contents. M. Paul Jennséki vient de découvrir le truc de la cuiller. Il est là avec sa serviette dans le cou en train de nourrir en face de lui et en diagonale une petite fille qu'on a envoyé en enfer parce qu'elle ne croyait pas au bon Dieu. Elle était un peu comme le pantin qui tournait le dos à l'Océan. Mais le bon Dieu est tellement bon qu'il va tout de même la sauver.
Ce Paul Jennséki est très prudent. Il a mis entre sa femme et lui deux autres personnages. Tu te rappelles, ma chère chérie-amour que sur terre elle le battait avec un tisonnier quand il rentrait tard du café.
Mais Madame Jennséki a compris plus vite que les autres la leçon donnée par son mari. Tu la vois qui nourrit, elle aussi, le voisin d'en face. C'est un huissier qui lui a saisi ses meubles un jour où elle n'avait pu payer son terme. C'est très gentil de la part de Madame Jennséki d'avoir pardonné à cet huissier à lunettes qui lui a fait tant de mal sur terre. Et c'est la morale de mon histoire. Qui aime son prochain et surtout son ennemi est sauvé. Voilà pourquoi j'ai fait à la fin un dessin symbolique : deux cuillers croisées sur un cœur.
Je ne connais pas le nom des autres convives. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour être expédiés en enfer. A l'arrière-plan, les pointes rouges que tu aperçois sont les flammes de l'enfer.
Tantale n'est pas là. Puisqu'il est toujours seul.
Sur le devant de la table, regarde ce petit diablotin. Il avait surpris le geste de M. Jennséki. Et il était allé prévenir le diable de garde. Mais nul n'avait fait attention à lui. Car les grandes personnes n'écoutent jamais ce que dit un enfant. C'est ce qui a permis à tous ces convives de se sauver au ciel plus tard.
La lumière du Dragon
Ceci est le fond, le tréfonds, le fin fond, le fond des fonds de l'étang. A l'arrière-plan, il y a le plus beau des châteaux où le dragon tient enfermée la plus belle des princesses. C'est pour cela qu'on ne la voit pas sur ce dessin.
Il a l'air très méchant, ce dragon avec ses écailles d'or. En ce moment il joue. Il a enlevé son bijou, le bijou lumière, ce bijou qui vaut sept empires. Et il joue à se faire peur. Mais il ne risque rien. Car le prince Gabriel et son fidèle Pierre ne sont pas encore arrivés.
A la fin de l'histoire il y a Monsieur et Madame Phénix qui se racontent des secrets comme des vraies commères.
Le pacte avec le Roi des Puces
Tu ne trouveras qu'à la fin le Roi des Puces avec son oriflamme : « Nous voulons du chien ».
Pour le moment tu ne peux pas le voir, parce qu'il est dans le rêve de la Dame-qui-dort. Et puis mon lit est très joli comme ça. Alors je ne veux pas le surcharger avec une armée de puces.
Il n'y a là ni le Monsieur-qui-a-tous-les-droits-sur-ma-vie, ni l'Enfant-qui-cherche-l'Aventure, ni Kand-on-Nourry, ni le chien Cory, ni Baby-Blue, parce que tout le monde est scandalisé par les mauvaises relations de la Dame-qui-dort. Personne ne veut fréquenter le Roi des Puces et ses quatre-cent quatre-vingts enfants.
Les aventures d'un atome d'azote
Ce que tu vois là est la fameuse bataille des globules blancs (que les savants appellent leucocytes) et des microbes, qui se passe dans le corps de bébé quand il est malade. Seulement au lieu de streptocoques, j'ai dessiné leurs cousins germains, les vibrions septiques parce qu'ils sont plus photogéniques... Ce sont ces espèces d'araignées à pattes crochues qui sont dans le bas. Les vibrions sont plus nombreux et plus petits. Mais les grands globules blancs qui se trouvent dans le sang de Bébé sont plus malins. Dans la première rangée du haut tu remarqueras qu'ils sont ronds. C'est leur état naturel en temps de paix. Mais à mesure qu'ils se rapprochent de l'ennemi, il étirent un pseudopode, qui est comme un pied. Ils attrapent le microbe et le mangent. Dans la dernière rangée, face aux vilaines petites araignées, tu trouveras trois globules blancs qui sont en train de digérer un vibrion chacun. Quand les vibrions seront tous morts, l'enfant sera guéri. Le bon Dieu a ainsi placé dans notre corps tout ce qu'il faut pour nous défendre.
Tout en haut et au milieu du double petit rond est le portrait d'Azote (très agrandi naturellement). Le point noir au milieu c'est le proton qui correspond au soleil de notre système solaire. Les deux petits points sur le cercle intérieur et les cinq petits points sur le cercle extérieur sont les sept électrons qui sont comme nos planètes qui tournent autour du soleil. L'infiniment petit ressemble à l'infiniment grand. Les rayons dans les deux coins sont les trajets des particules atomiques tels que les représente le professeur Jean Perrin. Le petit dessin avec les lignes tremblées entre l'atome d'azote et la bataille des leucocytes avec les vibrions c'est le trajet des électrons après le passage des rayons X. Tu ne trouves pas que ça fait joli ?
A la fin tu verras Juliette en carmélite à côté de la plus grosse machine du monde qui sert au bombardement atomique. Le petit atome d'azote est en train d'exploser.
La bobine de fil
La Princesse Roserouge rêve à sa robe à traîne, à son collier de perles, au beau danseur en habit qui lui dira des choses gentilles et tendres, à son premier bébé aux yeux bleus.
Elle tripote entre ses petits doigts le fil de sa bobine de vie. Les ciseaux sont à côté d'elle. On ne voit pas qu'ils sont en or. Je crois que j'ai oublié de te dire, ma chère chérie-amour, que je n'ai droit qu'à une seule couleur... Alors je l'ai employée pour le ciel plutôt que pour l'or des ciseaux. Mais ils sont en or quand même.
Couper quelques jours de vie pour rapprocher les minutes de joie... De là l'expression bien connue : « Je donnerais dix ans de ma vie pour ceci ou cela ». Quelle tentation !
Mais toi, tu n'es pas comme Roserouge, ma chère chérie-amour. Tu ne trompes pas ton Ange gardien.
— Contes de Fées :
L'art, et en particulier la peinture, est présent dans de nombreux écrits de Maryse Choisy.
Concluons avec un extrait de trois de ses romans.
Dans son premier livre, Presque (1924), elle raconte l'histoire d'un prince hindou tombé amoureux de la Joconde de Léonard (pp. 25-27) :
— Un jour que, dans le Louvre, au visuel contact de quelque chair heureuse et délicate de septentrionale Vénus, je cherchais à consoler mon désœuvrement, mes regards par la Joconde furent attirés. Elle m'apparut telle que jamais encore ne la vis, elle m'apparut immortelle, inexplicable, divine.
[...] Mona Lisa, mon cher ami, est une déesse, elle semble indubitablement quelque incarnation non dévoilée jusqu'à présent de l'universelle Kali. Souviens-toi que Leonardo da Vinci était un théosophe et un "initié". La Joconde n'est pas un corps, c'est une Pensée. Si jamais tes soucis te laissent le temps de visiter le Louvre, poursuivit le Maharadja après quelques instants de réflexion, examine surtout le brillant et l'eau de ses yeux, bien à elle. L'humidité de l'iris est d'une saisissante vérité qu'on ne retrouve en aucune autre peinture. Ils vivent, les yeux de la Gioconda, et pourtant son teint n'appartient point à ce monde. Il semble gris sur un fonds plus gris encore ; il n'est pas d'une femme mortelle.
— Mon ami, fit Julien, c'est précisément où tu te trompes. Vasari raconte au contraire que la Joconde était un chef-d’œuvre de coloris. Il loue avec enthousiasme le brun des cheveux et des sourcils, le ton chaud des roses chairs, le carmin des lèvres. Il nous dit même que pour obtenir cet effet réaliste, le peintre, pendant les quatre années que dura l'exécution de ce portrait, prenait un soin infini d'amuser son modèle, allant jusqu'à commander des musiciens spéciaux pour les séances. Le gris actuel que tu vantes est dû à la main d'un restaurateur stupide et ignorant.
— C'est le restaurateur qui a raison, répliqua Siddhy. L'esclavage du réalisme est un préjugé européen. L'esprit est tout ce qui importe. On ne me fera point accroire, que Leonardo n'ait voulu révéler en Mona Lisa une déesse.
Dans Don Juan de Paris (1933, pp. 163-168), la part d'autobiographie ne doit pas être négligeable :
Pour retrouver l'équilibre elle se rejette sur l'art. Signe d'impuissance. Un être parfaitement heureux ne produirait rien. Un peuple parfaitement heureux n'aurait pas d'art national.
Il n'y a pas d'inquiétude moderne. Les artistes furent de tous temps, en tous lieux, des inquiets. C'est parce qu'ils étaient des inquiets qu'ils sont devenus artistes. Il leur fallait une raison de vivre pleinement leurs fantaisies dans une société qui ne pardonne pas à la fantaisie. L'art est un prétexte, un alibi, un exutoire comme l'alcool, l'opium, la folie, le rêve. Pour un Freud une œuvre est plus féconde qu'un rêve. Les mêmes désirs inhibés, masqués en symboles s'y retrouvent à la fête vénitienne de la psychanalyse.
La création doit tomber de l'artiste comme une pomme mûre dégringole de l'arbre qui l'a longtemps portée. L'arbre n'y peut rien. L'artiste non plus. Mais si l'artiste ne crachait pas il étoufferait.
... Nicole songe à un panneau immense comme ceux des peintres du Moyen-Age : Le Dictateur...
Rien ne se crée de rien. L'artiste a besoin de vivre. Vivre égale recharger le subconscient d'oxygène. Vivre égale respirer.
L'artiste respire l'univers. Il l'expire en le marquant de son haleine. Sa grandeur dépend de la largeur, de la profondeur de sa respiration. Comme toute respiration, elle a deux mouvements : inspiration, expiration. Certains artistes touchent à peine la réalité. Mais ce qu'ils inspirent, ils l'inspirent profondément. La combustion est lente, longue. Ainsi les psychologues. D'autres n'expirent que leur propre haleine viciée. Les plus grands halètent, en communion constante, atome contre atome, peau contre peau, âme à âme, avec la moindre parcelle ou la plus immense planète. Ils montent et descendent les degrés de l'Univers comme l'escalier dans leur propre maison. Ils sont notre échelle de Jacob. Par eux nous connaissons l'Univers. Les grands artistes sont de grands médiums. L'Univers se prolonge en eux. Ils se prolongent dans l'Univers. Leur haleine est pure, parce qu'ils ont respiré un air de montagne, tout près du ciel. Celui qui habite trop longtemps dans les maisons closes, aura la bouche pleine d'acide carbonique.
... Nicole rêve toujours au Dictateur. Naturellement il aura les traits de Robert... Pourrait-elle faire autre chose que du « Rochefortisme » ?...
La morale de la création a un aspect négatif : le renoncement et un aspect positif : l'amour. Hors de l'amour, point de connaissance, point de communion avec le sujet, point de prolongement dans l'Univers. La guerre de Troie, la nomination d'un Dictateur sont des communiqués de l'Agence Havas. Mais la douleur d’Énée, mais la fidélité de Pénélope, mais un Dictateur qui a le visage de Robert, font verser des larmes, deviennent des œuvres d'art. Les faits divers, les lois de la gravitation, la guerre de Cent Ans, des abstractions sans réalité. Un seul fait divers, une seule pomme qui tombe, un seul soldat de cette guerre dans ses relations sentimentales et familiales, c'est la communion avec la réalité, c'est le domaine de l'individu, de l'art, de Dieu.
... Nicole voit un Dictateur entouré de femmes. Les unes ont des ailes... D'autres traînent à terre, blessées...
... La morale négative, seule, rendrait l'artiste sec comme un bâton de vieux célibataire, stérile comme le Sahara. Mais l'aspect positif n'est guère possible sans l'aspect négatif. Pas d'amour sans renoncement. Tristan est le pôle opposé de Don Juan. L'Amour (avec une majuscule) chasse toute les petites amours. Perfection implique choix. Choisir, c'est rejeter tout ce qui n'est pas choisi.
Pour l'artiste, vivre égale donc aussi ne pas vivre, maîtriser ses nombreux « moi » au profit de son meilleur moi, arrêter la réaction à mi-chemin de sa joie, être ascète. Hygiène de surhomme, quoi ! Peut-être n'aurions-nous pas eu la Divine Comédie si Dante avait épousé Béatrice. Tant pis pour nous. Mais pour Dante ? Son avis n'est pas à négliger... Bonheur ou carrière ? Toujours ce dilemme... Et le triste mot de Balzac : « Chaque femme avec laquelle on couche est un livre qu'on écrit en moins. »
... Nicole esquisse fiévreusement une ébauche du Dictateur... Le ciel là-haut... Les opprimées en bas, à ras de terre, entre les crapauds... Dans ce coin... Non, ce n'est pas ça... Elle ferme un œil pour mieux voir... La tête penchée à un angle de 45°, elle contrôle... Ce réalisme est de mauvais goût. Le Dictateur demande plus de rêve... La vie n'est jamais vraisemblable. Il faut la corriger, cette garce qui n'est pas en règle avec les règles....
Tableau ou amant ? Carrière ou bonheur ? Travail ou amour ? Dictateur en huiles ou Robert en chair et en sexe ?... Et pourtant il faut que ce dilemme se présente. Il faut que Dante connaisse Béatrice. Il faut que le poète ait envie de coucher avec la femme. Il faut que Nicole pleure à cause de Robert... Voilà le douloureux paradoxe de la création : Être et ne pas être. That is the question !
... Nicole, avec une chaleur au cerveau, dans les mains, dans les pieds, efface tout. Elle prend une autre toile... Son Dictateur est inférieur au modèle... Plus de muscle, plus de nerf, que diable !... C'est comme l'imitation de l'amour au théâtre : c'est artificiel, mesquin à côté de la véritable passion... Quand une actrice aime, elle est incapable de jouer une scène d'amour... Juliette, Roméo sont faux comme les décors. La vie tue l'art. Nicole voudrait pleurer, mordre, griffer, bondir. Elle recommence trois toiles. Elle se fâche. Elle jette les pinceaux.
Toute l'intrigue du Portrait de Juliette Delmet (1942) se situe dans le monde des artistes. C'est un roman sur l'art et ses difficultés :
Puis il montera dans son atelier pour voir si sa Madeleine aux pieds du Christ est toujours là. Chaque peintre a ainsi son tableau préféré, secret, celui qu'on ne vend pas parce qu'on y a mis tout ce qu'on possède de meilleur.
On l'a commencé comme une besogne ordinaire, peut-être même sans entrain, comme un pensum. Il se présentait mal. Il y avait des difficultés dont on ne croyait pas venir à bout. On était tenté d'effacer, de gratter, de retourner la toile, de faire autre chose.
Puis, peu à peu, on a senti qu'on travaillait sur un autre plan - est-ce le plan du génie ? - qu'on avait une vision plus claire, une main plus déliée, plus inventive, qu'on allait saisir et rendre un aspect essentiel de la vie. Sans doute sera-t-il imperceptible aux autres. Mais on est sûr de l'avoir mystérieusement rencontré.
(p.24)
On y trouve aussi cette amusante conversation (pp. 12-15) :
On demandait à Charles Delmet s'il était content de son vernissage. (C'était d'ailleurs le prétexte de sa fugue à Paris.)
Et, de nouveau, Rienzi enchaînait :
— Te rappelles-tu ce fameux vernissage où Antonini avait présenté des lignes brisées ? « Paysages de femmes » qu'il appelait ça. La tête des bourgeois !
Delmet ne goûtait pas cette plaisanterie.
— Il faut te rendre cette justice, le taquinait Lucien Destreilles. Tu n'as jamais été « fauve », même pas à vingt ans.
Non, Delmet n'aimait pas les embardées sur la route droite de la technique. Il y avait des lois pour les valeurs, des règles pour les ombres. Tout ce qui s'éloignait du style classique lui causait une véritable souffrance nerveuse. « Il fait ressemblant », disaient le lui les jeunes. « Il fait ressemblant », disaient les bourgeois qui commandent un portrait le jour du ruban rouge. (Ce sont eux qui paient, évidemment.)
Lenormand aussi conta son histoire :
— On naît peintre. On ne le devient pas. On a ou on n'a pas une palette riche dans le ventre. Ainsi te rappelles-tu le douanier Velteret ? Les snobs l'avaient adopté. Ce n'était pas mal d'ailleurs ce qu'il faisait.
Delmet fit une moue :
— Du débraillé.
— Mais non, insista Lenormand.C'était frais, naïf. Pas facile de faire du naïf. Malheureusement un jour Velteret se prit au sérieux. Il suivit des leçons de peinture chez un membre de l'Institut. On lui enseigna qu'on n'avait pas le droit de mélanger certaines couleurs. Chaque fois qu'il s'asseyait devant une toile, il se demandait avec angoisse : « M'est-il permis de faire ça ? » Jamais plus il n'a peint depuis.
[...] Mais Pierre Tessier défendit Antonini :
— Je ne déteste pas ses « Paysages de femmes ». En tout cas, Antonini a peint des morceaux de bravoure. Je me souviens d'un portrait notamment. Toute l'âme du personnage y était. Quelque chose de spirituel s'en dégageait.
Personne n'osa le contredire. Pierre Tessier était un critique d'art à la plume longue. Quand il écrivait « c'est bien », tous les marchands de tableaux de France et d'Amérique chantaient « amen ». Il était aussi poète. Mais ce métier-là n'a aucune importance sociale. Aujourd'hui, c'est une injure polie.
Seul Charles Delmet avait assez de clientèle, d'assurance, de vanité pour émettre une opinion personnelle :
— Cher ami, je vous assure, dans une toile, l'âme, le rêve, c'est de la littérature. Un tableau est juste ou pas juste. Vous aurez beau crier qu'un peintre a exprimé le caractère de son modèle... Imagination que tout cela. Dans un paysage on peut mettre ce qu'on veut, changer la couleur d'un arbre, l'emplacement d'une verdure... L'impression y est...
— Pardon, pardon, interrompit Lenormand. Là aussi on voit juste ou pas juste. Je reviens de l'île de Ré. Toutes nos conventions y sont renversées. La lumière est telle que les ombres sont plus claires que les parties ensoleillées. Il y a des rapports nouveaux. Les ombres se projettent les unes sur les autres.
Delmet s'impatienta :
— Tu ne fais que confirmer ma thèse. Pour exprimer ça, tu truques. Dans un portrait, c'est autre chose. Il faut faire la ligne exacte, la valeur juste, le plan à sa place. Sans ça, tout est fichu.
Pierre Tessier en tenait pour son âme :
— La technique n'est pas tout. Un bon peintre est d'abord un psychologue. Je dirai même : il est peintre parce qu'il est le meilleur psychologue. Dans la vie ordinaire, nous n'observons rien. Nous ne pénétrons le secret d'un être qu'après avoir fait son portrait.
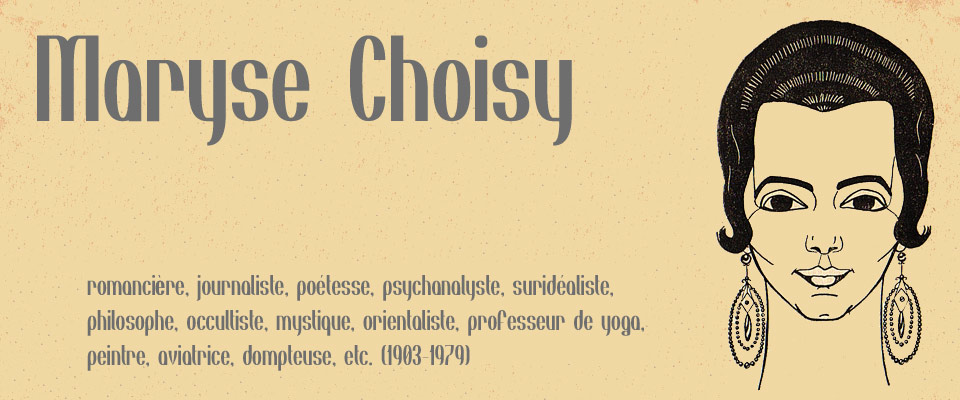










































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire